Le 29 mars 2025, par Urbanitas.fr. Temps de lecture : cinq minutes.
Passage à l’heure d’été 2025 ce dimanche : pourquoi un changement d’heure saisonnier en France et en Europe ?
Culture et société
Le passage à l’heure d’été aura lieu le dimanche 30 mars 2025. Cet événement, instauré en 1976 en France, soulève des questions sur ses origines, son impact économique et son avenir potentiel. Pourquoi ce changement ? Quelles sont ses conséquences économiques ? Et surtout, cette pratique est-elle amenée à disparaître ? Plongez au cœur d’un débat qui rythme notre quotidien.
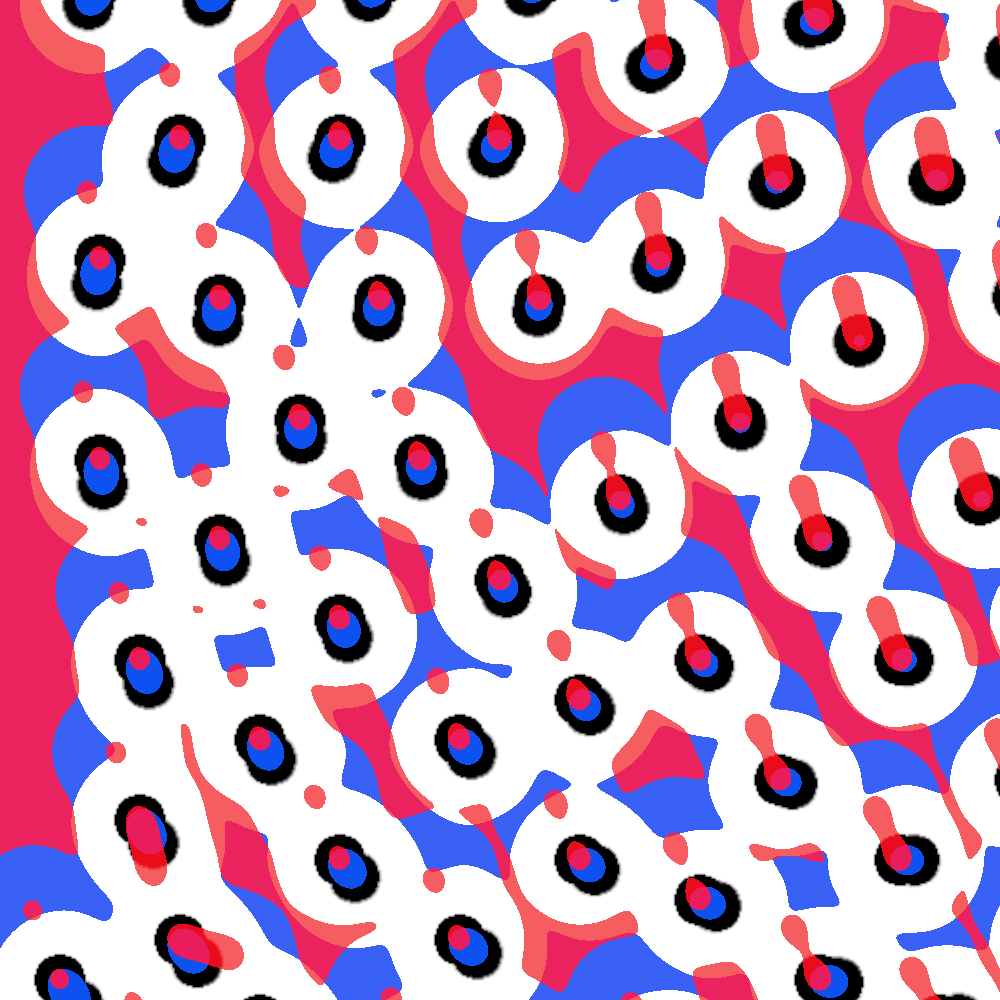
Le passage à l’heure d’été s’est effectué ce dimanche 30 mars 2025 à 2 heures du matin. Les horloges ont alors avancé d’une heure, passant directement à 3 heures. Cette pratique du changement d’heure, en vigueur en France hexagonale depuis 1976, s’inscrit dans une longue histoire d’ajustements horaires.
Historiquement, le changement d’heure a été appliqué pour la première fois en France en 1916, après l’Allemagne et le Royaume-Uni, dans un objectif d’économie des ressources énergétiques comme le charbon. Abandonné à la Libération en 1944, le système actuel a été réintroduit par le décret du 19 septembre 1975, dans le contexte du choc pétrolier de 1973-1974. L’objectif principal était alors de réduire la consommation d’électricité, produite à l’époque principalement par le fioul, en profitant d’une heure d’ensoleillement naturel supplémentaire le soir.
La nuit du dernier samedi au dimanche de mars
Cette mesure, initialement conçue comme provisoire, s’est pérennisée. L’heure légale française est actuellement fixée à UTC+1 en hiver et UTC+2 en été. Il est à noter que les territoires d’outre-mer ne sont pas concernés par ce changement saisonnier, à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces territoires disposent d’un temps légal défini par un décret spécifique de mars 2017.
Au niveau européen, l’heure estivale s’est progressivement généralisée à tous les pays de l’Union dans les années 1980. Pour faciliter les échanges intracommunautaires, la directive 2000/84/CE du 19 janvier 2001 a harmonisé les dates de changement d’heure. Depuis 2002, tous les États membres effectuent simultanément le passage à l’heure d’été lors de la nuit du dernier samedi au dimanche de mars, et le retour à l’heure d’hiver lors de la nuit du dernier samedi au dimanche d’octobre.
Malgré cette harmonisation, les pays de l’Union européenne restent répartis sur trois fuseaux horaires différents : l’Europe occidentale (UTC) comprenant actuellement l’Irlande et le Portugal ; l’Europe centrale (UTC+1) regroupant notamment la France, l’Allemagne et l’Espagne ; et l’Europe orientale (UTC+2) incluant entre autres la Grèce, la Finlande et la Roumanie.
Consultation publique de 2018
Selon une étude de l’Agence de la transition écologique publiée en 2010, les effets de l’heure d’été seraient positifs sur la consommation d’énergie et les émissions de CO2. Cependant, le débat sur la pertinence du changement d’heure saisonnier reste ouvert.
La Commission européenne a récemment annoncé, dans son programme de travail pour 2025, la reprise de sa proposition de directive de mars 2019 visant à supprimer le changement d’heure saisonnier. Cette discussion avait été interrompue par la crise sanitaire liée au Covid-19. Le projet prévoit que chaque État membre pourrait choisir de rester à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver. Toutefois, le Parlement européen a souligné la nécessité d’une coordination entre les pays afin de ne pas perturber le fonctionnement du marché intérieur.
Une consultation publique menée par la Commission européenne en 2018 avait recueilli plus de 4,6 millions de réponses, avec 84 % des participants favorables à la suppression du changement d’heure. En France, une consultation similaire organisée par l’Assemblée nationale début 2019 avait abouti aux mêmes conclusions.
À l’échelle mondiale, plusieurs pays appliquent des changements horaires saisonniers, parfois de façon hétérogène sur leur territoire comme au Canada, aux États-Unis ou en Australie. D’autres pays comme l’Argentine, la Tunisie, la Turquie et la Russie ont choisi d’abandonner cette pratique.
préoccupations du secteur agricole
Le Parlement européen s’était prononcé en faveur d’une suppression du changement d’heure saisonnier dès 2021. Cette position, exprimée lors d’une réunion en séance plénière à Strasbourg, rejoignait celle exprimée par les Français lors d’une consultation initiée par l’Assemblée nationale, lors de laquelle 83,7% des 2,1 millions de participants s’étaient déclarés favorables à l’arrêt de la pratique biannuelle de changement d’heure.
Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), le passage à l’heure d’été permettait d’éviter les rejets de 50 000 tonnes de CO2 et d’économiser plus de 350 GWh d’électricité, soit 0,07% de la consommation électrique nationale. Toutefois, ces économies s’avéraient en constante diminution grâce à l’amélioration des systèmes d’éclairage et au renforcement des politiques énergétiques. L’Ademe prévoyait qu’elles ne représenteraient plus que 258 GWh à l’horizon 2030, réduisant l’intérêt originel du dispositif.
Le secteur agricole avait déjà exprimé des préoccupations particulières face à cette réforme potentielle. Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA, soulignait que le maintien permanent de l’heure d’été décalerait significativement l’organisation des récoltes, nécessitant d’attendre plus longtemps l’évaporation de l’humidité et imposant davantage de travail nocturne. Pour les éleveurs en revanche, la réforme supprimant le dispositif serait bonne : les animaux, rythmés par la lumière naturelle, subissent un stress d’adaptation à chaque changement d’heure saisonnier durant approximativement une semaine.
Dans le domaine des transports, l’Association internationale du transport aérien (IATA) et d’autres organisations du secteur aéronautique ont manifesté leurs inquiétudes quant à l’abolition du changement d’heure. Elles y voient un risque majeur de désorganisation du trafic aérien mondial, avec des plannings de vols à reconfigurer entièrement et des congestions potentielles dans certains grands aéroports internationaux.
Concernant la sécurité routière, l’argument principal en faveur de l’heure d’été fixe est la réduction présumée des accidents grâce à une meilleure luminosité en soirée. L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière rapportait ainsi en 2024 une augmentation de plus de 40% des accidents corporels impliquant des piétons entre 17h et 19h après le passage à l’heure d’hiver. Cependant, le Sénat nuance cet avantage, rappelant que l’obscurité prolongée le matin en hiver accroît les risques d’accidents liés au verglas.
Pour le secteur du tourisme et des loisirs, les conséquences à long terme semblent mitigées. Si certains restaurateurs, comme Mathéo Charlot à Sausset-les-Pins, bénéficient d’une hausse de fréquentation en soirée grâce au coucher de soleil tardif, permettant de vendre davantage de boissons à forte marge, d’autres activités nocturnes comme les théâtres ou cinémas pourraient en pâtir. L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) considère cependant le changement d’heure comme un non-sujet, estimant que chacun s’adapte comme c’est le cas depuis les années 1970.
Urbanitas.fr
Quiz sur le changement d’heure en France et dans le monde
Passage à l’heure d’été 2025. — À quelle date aura lieu le passage à l’heure d’été en France en 2025 ?
A. Dimanche 23 mars. — B. Dimanche 30 mars. — C. Dimanche 6 avril.
Dimanche 30 mars
Origine du changement d’heure. — Dans quel contexte le changement d’heure a-t-il été instauré en France en 1976 ?
A. La crise économique de 1929. — B. Les chocs pétroliers des années 1970. — C. La Guerre froide.
Les chocs pétroliers des années 1970
Harmonisation européenne. — Depuis quand le changement d’heure est-il harmonisé au niveau européen ?
A. 1980. — B. 2002. — C. 2015.
2002
Avenir du changement d’heure. — Quelle est la position actuelle de la Commission européenne concernant le changement d’heure ?
A. Maintien du système actuel. — B. Suppression du changement d’heure. — C. Passage à une heure d’été permanente.
Suppression du changement d’heure
Pratiques mondiales. — Comment les changements d’horaires saisonniers sont-ils appliqués dans le monde ?
A. De manière uniforme dans tous les pays. — B. De manière hétérogène selon les pays. — C. Exclusivement en Europe.
De manière hétérogène selon les pays
En savoir plus sur ce sujet
Ressource : Décret n°75-866 du 19 septembre 1975 RELATIF A L’HEURE LEGALE EN 1976 (legifrance.gouv.fr)
Ressource : Décret n° 2017-292 du 6 mars 2017 relatif au temps légal français (legifrance.gouv.fr)
Ressource : Faut-il en finir avec l’heure d’été ? Rapport d’information n° 13 (1996-1997), déposé le 9 octobre 1996 (senat.fr)
Ressource : Passage à l’heure d’hiver. Observatoire national interministériel de la sécurité routière (onisr.securite-routiere.gouv.fr)
Entités liées
Commission européenne, Union européenne, Directive 2000/84/CE, Agence de la transition écologique, Fuseaux horaires, Économies d’énergie, Choc pétrolier, Temps universel coordonné (UTC).
L’actualité : derniers articles
Réforme de l’audiovisuel public : deux jours de grève et des débats suspendus après une altercation
Forum InCyber 2025 : une 17e édition à dimension internationale
Nouvelles technologies | Le 1er avril 2025, par Urbanitas.fr.